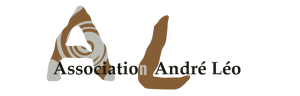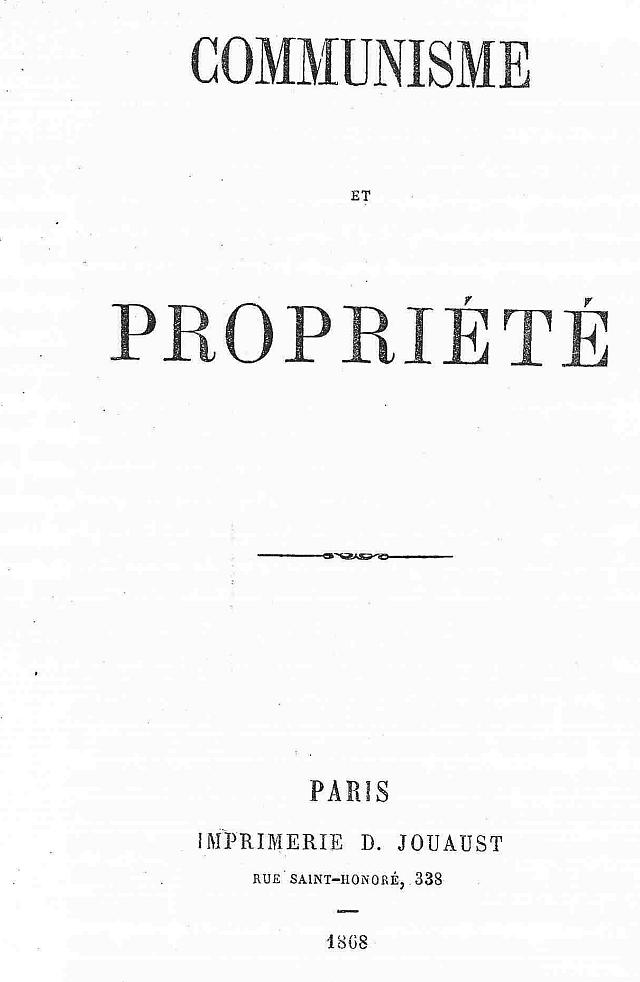COMMUNISME et PROPRIETE
La question qui divise si profondément les esprits à notre époque se pose de nouveau, ravivant les inquiétudes et les haines, qu’elle a toujours excitées. La propriété restera-t-elle l’apanage de quelques-uns ? ou deviendra-t-elle le droit de tous ? L’affirmation et la négation se heurtent sur ce point avec violence. Ici, d’âpres intérêts soulevés ; là, une foi quelque peu farouche. Est-ce la liberté qui doit prévaloir, ou l’égalité ? Antagonisme apparent de deux principes qui, à l’heure qu’il est, partagent la démocratie et jettent la discorde dans ses assemblées, bien qu’ils composent au même titre sa devise, et que leur accord seul puisse donner au monde la justice .
Aux yeux des partisans de la liberté, l’égalité menace tyrannie. Aux yeux des égalitaires, la liberté sans l’égalité n’est qu’un mensonge. Ceux-là redoutent le communisme, et ceux-ci combattent l’exploitation. Les ennemis de la démocratie triomphant de ces luttes et parviennent facilement à soulever l’opinion publique, encore trop habituée aux dogmes tout faits pour ne pas contempler avec intolérance l’enfantement pénible de dogmes nouveaux.
Malgré les anathèmes anciens et actuels, cependant, la question est toujours là . Combattu, honni, écrasé, le socialisme persiste. Il y a donc peut-être quelque chose en lui. Que revendique-t-il ? - La justice. - Existe-t-elle ? - Non. Affirmer le contraire serait nier l’évidence, et personne ne l’osera ; les faits parlent. Même les plus satisfaits avouent qu’il y a beaucoup à faire. Car enfin, la misère et la pauvreté règnent sur le plus grand nombre, et la nuit de l’ignorance couvre les trois quarts de ce qu’on nomme le monde civilisé.
Est-ce avec la constitution actuelle des choses que cela pourra changer ? D’après la somme annuelle de nos progrès, ce serait long… et douteux. Peut-on trouver des moyens plus prompts et plus vrais ? – Pourquoi pas ? D’ailleurs, l’énigme, quoi qu’on fasse, est posée et menace de dévorer qui ne saurait la résoudre. C’est la multitude qui règne, la multitude ignorante et misérable. Etonnée encore, incertaine, elle voudra tôt ou tard, demain peut-être, porter remède à ses maux, et ce remède, pris au hasard, peut être fatal. De par le suffrage universel, la solidarité ne saurait plus être niée ; la solution du problème importe à tous. Il est donc utile de la chercher, et les prudents, au lieu de condamner cette recherche, la devrait encourager.
Mais comment chercher fructueusement, si ce n’est avec une sincérité entière, et sans peur de l’inconnue qui doit apparaître ?
Faire des réserves d’avance, interdire certains sujets, n’est pas sérieux. L’esprit humain ne s’assure de ses croyances qu’en les considérant à nouveau, et ne point oser les sonder prouve peu de confiance en elles. – Il est même singulier que ce manque de respect soit le fait de tous les dévots.
Cependant, tout le monde le reconnaît, un grand malaise existe, qui peut devenir un grand désordre. La question politique se trouve résolue en droit, sommairement, par le suffrage universel ; mais par le fait social elle n’aboutit qu’à un malentendu immense et qui doit durer tant que dureront les mêmes effets d’ignorance et de misère. C’est un cercle vicieux à rompre. Chacun possède sa part de souveraineté ; c’est le droit égal, reconnu, de tous. Mais l’égalité reste fictive tant que chacun ne possède pas la même part d’avantages en compensation des mêmes devoirs.
Nous avons, il est vrai, le système qui consiste à faire des biens sociaux la récompense du plus fort, ou du plus habile, tous étant admis au concours. Beaucoup prennent cela pour la justice même . Au fond , ce n’est pas autre chose que la loterie appliquée à l’ordre social, le sort distribuant les capacités comme les numéros. C’est encore une sorte de mât de cocagne. Mais ce système si vanté, fort habile d’ailleurs, n’est pas un système social digne de ce nom. Il change la situation des individus, il ne change pas celle des masses ; il aplanit les obstacles que rencontrait autrefois la basse naissance, mais il conserve, quant à l’ensemble, les mêmes rapports d’inégalité. Peu importe, en effet, au point de vue général, que tel ou tel heureux soit parti de telle ou telle condition ; ce qui importe, c’est que l’éducation, le loisir et le bien-être, les richesses morales et intellectuelles de l’humanité, sont toujours dévolus au petit nombre, tandis que la masse en est privée. Le droit politique est une erreur, ou un mensonge, s’il n’implique pas le droit social.
La liberté porte-t-elle en elle-même, ainsi que l’affirment le économistes, la solution du problème ? Elle ne le formule point, en tout cas, et nous laisse toute l’incertitude de ses décisions. Car la liberté, cette divinité si chère aux opprimés, cette brûlante aspiration des esclaves, n’est pas en soi un principe actif, n’est pas une loi susceptible de développements, n’est pas une science. La liberté correspond, dans l’ordre moral, à la santé dans l’ordre physique ; elle est l’absence du mal ; elle permet tout ; elle ne donne rien. Les forces créatrices avec elle ont toute leur puissance ; mais c’est l’état normal ; si le compression les altère, la liberté n’y ajoute pas. Tout l’état antérieur de l’humanité nous a fait de la liberté un être enivrant, une déesse ; et si elle ne peut donner, ce qu’elle doit nous rendre assurément est immense en comparaison de ce qui est. Mais ses bienfaits n’existent que par opposition aux maux de l’esclavage. C’est la loi de notre expansion individuelle ; ce n’est pas la loi sociale ; ce n’est pas un principe organisateur.
La loi sociale, c’est la justice.- Et, sous un autre nom, la justice c’est l’égalité.
On peut discuter les applications de l’égalité, mais on ne peut soutenir qu’elle ne soit pas le fondement de la notion de justice. Les tribunaux n’en ont pas d’autre et l’appliquent même avec une rigueur élémentaire, soumettant à le même peine l’homme instruit et l’ignorant, le faible et le fort. Tous nos jugements, en ce qu’ils ont de général, n’ont point d’autre base que l’égalité humaine. Toute comparaison s’y fonde. En ce temps où nous sommes, enfin, nulle affirmation n’est plus générale et plus accentuée. Nous ne différons que sur les moyens de faire passer l’égalité dans les faits ; mais là nous différons, il est vrai, beaucoup. En négligeant le vieux système des castes, qui a fait son temps, nous trouvons l’application la plus restreinte de l’égalité dans le système, examiné tout à l’heure, du mât de cocagne social ; la plus étendue, c’est le communisme.
Le communisme, c’est-à-dire le possession commune des bien sociaux, qui emporte naturellement l’abolition de l’héritage, révolte, non-seulement ceux qui s’effrayent par nature d’esprit de tout changement, non-seulement ceux qui, satisfaits de leur part, n’en veulent point être dépouillés ; mais ces contradicteurs plus sérieux qui, reconnaissent dans l’individu la base du droit nouveau, considèrent comme immoral tout ce qui blesse ou diminue la responsabilité, la puissance et la dignité de l’être individuel.
Ce sentiment, qui est celui du plus grand nombre, s’est toujours affirmé avec énergie- en écartant même l’action de ceux qui s’en servent comme prétexte.
En effet, le produit de mon travail, le fruit de la dépense journalière de mes forces, de mes facultés personnelles, l’effort de mes bras, de mon intelligence, de ma volonté, mon œuvre enfin, la chose créée, sortie de moi-même, elle ne m’appartiendrait pas !... J’aurai dirigé tous mes actes, toutes mes pensées vers un but choisi par moi, et devenu l’ambition, la joie, la gloire ou l’utilité de ma vie, et je n’aurai point de droit sur ma création !... Je ne disposerai de quoi que ce soit ! Pour avoir droit à tout, je ne possèderai rien ! – Vous n’y songez pas. En voulant consacrer, suivant votre prétention, le droit de tous, vous violez le droit particulier. Votre égalité n’est pas de la justice.
Et non-seulement cela est injuste, mais cela est insensé. Car, en dépouillant ainsi l’être humain du fruit de son travail, vous supprimez l’appât, l’aiguillon, la récompense de toute activité. En éteignant son ambition, vous éteignez son énergie. Vous voulez constituer une société plus prospère, et vous amoindrissez l’individu ! Merveilleux calcul !
Pensez, vouloir, sans moyens propre de réaliser, c’est une compression, une souffrance, une lacune dans l’être. Si, pour donner une forme à ma pensée, pour transformer la matière, il me faut la permission du corps social, permission qui, naturellement, peut m’être refusée, il ne dépend plus de moi d’être moi, d’accomplir ma destinée. Mon ardeur, mes efforts, sont inutiles ; c’est la règle qui dispose, et ma pauvreté au sein de la richesse sociale n’est pas moindre que celle du prolétaire actuel ; car le plus âpre sens du mot pauvreté, c’est dépendance. C’est par là que la pauvreté abaisse ceux qu’elle frappe. C’est par là que la moitié de son âme est retirée à l’esclave. L’homme a besoin du pouvoir, non sur ses semblables, mais sur le monde. Créer de rien est un non-sens. Pour créer, il faut posséder, avoir à soi, ne devoir compte qu’à soi de ses essais, de ses fautes, être responsable et libre.
Le droit de propriété est donc bien un droit véritable et nécessaire. C’est la forme la plus accusée de l’individualité dans l’être, considéré seul. Assurément, vis-à-vis d’autrui, le droit, en se combinant, se modifie ; mais il ne peut être anéanti.
Or, si ce droit sacré de possession de mon œuvre m’est reconnu, si, me possédant moi-même, le produit de mes forces et de ma volonté m’appartient également, ce droit est entier, complet, et toute restriction le viole. Ce qui est à moi, donc, étant bien à moi, j’en puis disposer à mon gré. Je puis le donner aujourd’hui, demain, plus tard, le léguer enfin. Le droit ne se prescrit pas, en vraie justice. Le droit de propriété entraine donc le droit d’héritage.
Voyons maintenant les conséquences de ce droit, tel qu’il s’exerce dans la société actuelle. Ce sont elles qui frappent surtout les partisans de l’abolition de l’hérédité. Ces conséquences sont l’accumulation des produits du travail dans les mains blanches et effilées de celui qui ne s’est donné que la peine de naître ; c’est le spectacle, partout étalé sur notre terre, de familles nombreuses réduites à végéter sur un maigre enclos, ou même ne possédant rien, à côté de l’oisif, possesseur de vastes espaces, et vendant au travailleur le droit de vivre, sur enchère au rabais. C’est la récompense transmise à qui n’a rien mérité ; c’est l’inégalité perpétuée ; c’est, par une étrange filiation, le droit à l’oisiveté découlant du droit du travail devenu hiérarchique, et par ancienneté suzerain, c’est-à-dire oppresseur, du travail nouveau, le droit ennemi du droit, la justice contre la justice !
N’y a-t-il pas là une anomalie dont on doit chercher le nœud ?
Evidemment il y a erreur quelque part. Si le droit de propriété est un droit primordial, sacré, il appartient à tout homme, et doit être accessible à tous. Laissant de côté les rengaines sur la puissance de l’ordre, de l’économie, du labeur, etc., il faut reconnaître que tout le monde ne peut posséder un grand nombre d’hectares, de rente sur l’état, maisons, serviteurs. Si tout le monde était riche, il n’y aurait plus de travailleurs, conséquence absurde. Or, si tout le monde ne peut être rentier, la richesse, telle qu’elle est constituée actuellement, est un privilège, donc une immoralité. C’est fâcheux à dire, car cela indigne et fâche beaucoup de gens. Mais comment faire ? Ce n’est pas une opinion personnelle ; c’est une déduction rigoureuse du droit nouveau. La loi politique le reconnaît, le proclame, tous les hommes ont un droit égal. Or le principe de la rente est contraire au principe d’égalité.
Le point à saisir, dans ce débat, c’est où le droit individuel de propriété s’écarte du droit général.
Ne serait-ce pas lorsqu’il attribue au travailleur, outre le produit de ses peines, outre les améliorations apportées par lui au fonds cultivé, ce fonds lui-même ?
La terre est la propriété humaine. Elle appartient aussi bien aux générations à venir qu’aux générations présentes.
Dès lors, donner à tel homme, de telle époque, un droit perpétuel sur la terre, c’est posséder l’humanité future.
Et n’est-ce pas une absurdité que d’attribuer à un être qui passe – et si vite – une possession éternelle ?
On ne peut pas nier que la terre ne soit la propriété commune de l’humanité. Est-il juste, par conséquent, de l’aliéner aux mains de certaines familles ?
C’est ici que les communistes ont raison.
Et cependant, il faut le répéter, on ne peut frustrer un homme du prix de son travail, un père du droit de transmettre à ses enfants ce qui est à lui, un ami du même droit vis-à-vis de son ami.
Mais pourquoi confondre ces deux choses différentes : le fonds sur lequel s’exerce le travailleur, et le produit du travail ?
Une coutume existe dans nos campagnes : quant un fermier entre en possession d’une terre, on estime la valeur des instruments aratoires, du bétail et des provisions qui garnissent la ferme ; quand il la quitte, on les estime de nouveau et, selon que la valeur s’est accrue ou diminuée, le fermier se trouve créancier ou débiteur.
C’est l’application trop partielle, sauf les fermages, de la vraie loi de propriété.
L’homme est le fermier de la terre.
Son droit de propriété consiste dans les fruits de son travail, outre la plus-value qu’il donne, on peut donner, par ce même travail, au fonds qu’il exploite. Ce produit de son labeur et de sa capacité doit être compté, soit à lui, soit à ses enfants, lorsqu’il abandonne l’exploitation, - volontairement, ou par la mort. Aucun héritage n’est transmissible que celui-là ! mais il l’est en toute justice.
La même loi s’applique à tout bien foncier, à toute parcelle de terre occupée. Quand aux objets mobiliers, créés par l’industrie, amassés par l’épargne, ils comportent naturellement la propriété personnelle, par conséquent transmissible. Les maisons, en tant que maisons, également ; mais à condition d’une redevance pour la concession, toujours temporaire, du terrain sur lequel elles sont bâties.
Et le capital ? dira-t-on. La propriété foncière est loin de composer toute la richesse sociale . Il y a l’argent, la rente, les billets, les obligations… On peut être fort riche et ne pas posséder un pouce de terre.
Cela est difficile : chemins de fer, usines, canaux, tout cela pose sur le sol commun ; et quant à l’agiotage et à l’intérêt, ne comprend-on pas quel rude coup leur serait porté par un pareil changement dans l’économie sociale ? Supprimer la propriété foncière dans ce qu’elle a d’inique et d’exclusif, c’est rayer au compte de la rente bien des chiffres ; c’est reléguer le capital au rang modeste qu’il doit occuper ; d’autant plus sûrement que les facilités données au travail actif et vivant diminuent d’autant l’influence du travail acquis. Pris entre cette immense réforme et l’association, qui le combattra dans l’agriculture comme dans l’industrie, le capital ne pourra que céder ; périr, non ; car tant qu’il existera, c’est-à-dire tant qu’il représentera un travail, il représentera un droit.
Mais ce droit, soumis, comme le veulent les économistes, aux lois de l’offre et de la demande, passera de sa condition royale actuelle à un état plus modeste, toujours de par la force des choses, mais en vertu d’un ordre des choses différent.
Il me semble que les choses justes, qui sont les plus simples, se reconnaissent à ce signe de découler naturellement du droit et de n’avoir besoin, pour exister et se maintenir, d’aucun décret ni convention arbitraire. La propriété actuelle est si abusive, que dans l’intérêt public nos lois la violent à chaque instant, allant elles-mêmes ainsi, par nécessité, contre le principe de l’ordre établi- tantôt par la prescription, négation monstrueuse du droit reconnu, tantôt par l’augmentation progressive de l’impôt sur les héritages et les restrictions apportées au droit de tester, de recevoir, etc. De même, d’autre part, un ordre social de choses ne peut être décrété. L’humanité, de temps en temps, renouvelle ses lois par le progrès des mœurs et des idées, par une intelligence plus pure de la justice ; mais, dans cet ordre de choses comme parmi les êtres animés, il faut qu’une naissance et un développement correspondent à une décrépitude. Le terrorisme est faux en matières sociales comme en politiques. Il y a un droit, si faible soit-il, dans toute existence, et il n’est pas juste ni plus heureux, d’abolir le capital que de décapiter les rois. En fait, malgré les théories violentes, dont est responsable d’ailleurs pour moitié la violence des intérêts opposés , le progrès des idées et des mœurs s’accuse ; on ne décapite plus les couronnés, on les chasse ; le temps n’est pas loin, espérons-le où la cité, au sortir du palais, leur sera ouverte. C’est à partir de ce jour qu’il n’y aura plus de restauration.
Ainsi, le capital devrait continuer de se louer, pour tous les motifs légitimes qu’on allègue à cet égard. Ce n’est qu’à l’expansion d’une force opposée, plus utile et plus puissante, qu’il appartient de la réduire à sa véritable place. Si le grand instrument de travail, la terre, d’où tout part et où tout revient, était retranché, comme en justice il doit l’être, du domaine du capital, celui-ci n’aurait plus guère, en effet, d’autre rôle que celui de la bêche, à laquelle on l’a si souvent, et trop modestement, comparé. Il serait encore utile, mais ne serait plus indispensable. Au refus de la vieille bêche, une bêche neuve l’aurait bientôt remplacée, avance facile de l’ouvrier forgeron à l’ouvrier laboureur- car ce serait désormais au travailleur, sûr de trouver partout sa place, exempt de tout fermage, sauf l’impôt, possesseur de la totalité de sa récolte et seul créateur de la richesse, qu’appartiendrait naturellement le crédit, comme à la force la plus sûre et la plus vraie de ce monde. Que peut faire, en telles circonstances, une vieille bêche menacée de se rouiller, Se prêter de bonne grâce pour une redevance minime ; c’est ce qu’elle ferait.
Ne voudra-t-on voir en ceci que la ruine des capitalistes ? Mais pourquoi n’y verrait-on pas avant tout l’aisance et la paix rendues à l’humanité par la justice ? Dans un ordre de choses où le travail, libre et fructueux, serait assuré à tous, et tempéré, sans aucun doute, au sein de la prospérité sociale, par des loisirs suffisants, que regretter ? Les excès de l’oisiveté ? Ceux de la misère ? – Il faut prendre, bon gré mal gré, son parti du but ou nous mène la révolution. Sa triple formule n’est pas vaine . C’est une autre révélation ; elle doit s’accomplir.
Dans ce système, que fait l’état ? Rien de plus qu’aujourd’hui. Il veille à l’exécution du pacte social, perçoit l’impôt et le répartit. Chacun, chargé de soi-même, répond de ses actes et travaille pour soi.- Comment les terres s’adjugeraient-elles ? Je ne sais ; mais cela ne paraît pas bien difficile à trouver. Aux enchères, peut-être, sur le chiffre de l’impôt ? Ce que j’oserais affirmer, c’est que les fonctions parasites alimentées par le luxe, les chicanes, les vieilles lois et la vieille propriété, s’en iraient tout doucement, suivies des rentiers, et que l’oisiveté, ce rongeur de la richesse publique, disparaitrait de la terre. Il n’y aurait plus de capitalistes que les vieillards ; encore travailleraient-ils selon leurs forces. Travail étant devenu synonyme de noblesse et d’indépendance, qui n’en voudrait ?
Utopie ! dira-t-on ; mais l’accord de la liberté humaine et de la justice, heureusement, n’est point une utopie. Nos clartés de ce moment suffisent à montrer que de telles données ne sont pas de simples rêves. On reconnait en principe les droits du travail ; on est indécis que sur les moyens de les lui rendre.
Or, un moyen, fondé en droit, qui concilie l’individualisme et le communisme, l’égalité et la liberté, le droit complet de chacun et le droit de tous, en quoi serait-il impraticable, si ce n’est aux yeux des propriétaires ?
André Léo
Un ami avertit l’auteur que ses conclusions sont précisément celles de Proudhon dans ses Mémoires sur la propriété. Fallait-il supprimer cet écrit parce qu’il n’offrait plus une solution inédite ? Mais si elle est vraie, qu’importe ? les vérités ont besoin d’être dites plus d’une fois, et des esprits différents présentent ordinairement la même idée sous divers aspects. En somme, cela se réduisait à une question de priorité, toute personnelle, chose indifférente à l’idée comme au lecteur.
A. L
Format à télécharger