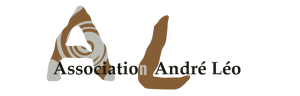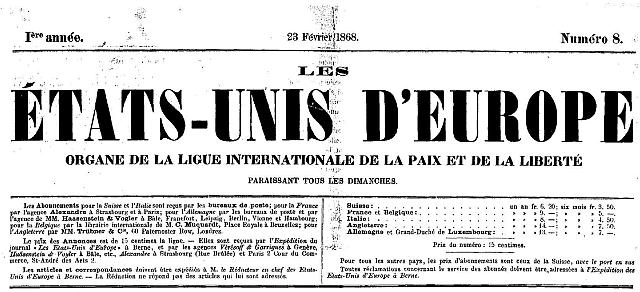Dans, Les ETATS UNIS D’EUROPE, du dimanche 05 janvier 1868
LA QUESTION DE LA PAIX DANS LES
CAMPAGNES DE FRANCE.
La conscription est le fléau de nos campagnes. Il est peu de familles où, grâce à elle, on n’ait de longs soupirs à donner à l’absent, qui souvent en était le membre le plus utile ; il en est beaucoup où le souvenir de ces expéditions guerrières fait couler des larmes amères. – « C’était le plus beau de mes garçons, dit en pleurant la vieille mère, et il m’avait donné tant de peine, hélas »
Où trouver un esprit mieux disposé à concevoir l’horreur de la guerre, et à désirer son abolition ? Ici l’œuvre du raisonnement est toute faite par le sentiment, par l’épreuve même.
Eh bien, essayez de dire à cette mère, à ces parents, dont la plaie est encore si vive, que la guerre peut être abolie, qu’il suffit de le vouloir, de le demander avec ensemble, de l’exiger. Vous n’obtiendrez
pour réponse qu’un étonnement plein de doute, presque railleur. – Est-ce que c’est possible qu’il n’y ait plus de guerre, puisqu’il y en a toujours eu ? – Telle est la pensée, exprimée ou muette, que provoque votre proposition ; elle laisse indifférent un esprit dont elle renverse toutes les données habituelles ; et comment s’étonner ici d’un tel résultat, quand on reçoit fréquemment la même réponse de la part de gens instruits, et autrement familiarisés avec la nouveauté dans l’idée.
Cependant, la réforme aurait ici pour levier un intérêt si puissant, si profond au cœur du peuple, qu’elle réussirait sans nul doute à soulever en sa faveur tous les paysans, si l’on pouvait user librement sur ce point des persuasions de l’écrit et de la parole.
Le jeune gars de 20 ans, habitué dans sa famille aux travaux de la ferme, et qui déjà fait la cour à son amoureuse, ou cherche autour de lui celle qu’il doit épouser, n’a quoiqu’en disent les platitudes officielles, aucun goût pour le métier de défenseur de la France ; d’abord parce qu’il sait très bien que son pays n’est point attaqué ; ensuite parce que, tout humainement, il tient à sa vie et n’accueille qu’avec frisson l’idée d’affronter les balles ; enfin parce qu’il se sent ruiné de la perte de ces sept années, les plus belles de sa vigueur et de sa jeunesse. Qu’il revienne ou ne revienne pas, il est perdu pour le village, pour l’agriculture, pour ce monde qui est le sien et qu’il aime. Ni lui ni ses parents ne s’y trompent : un fils à l’armée, c’est un membre de la famille retranché ; c’est un fils perdu. A son retour, en effet, le soldat ne devient point ce guerrier laboureur qui figure si bien dans les phrases toutes faites. Il a perdu l’habitude du travail ; il a pris celle de l’oisiveté ; il est démoralisé par la vie brutale et immonde de la caserne et des camps. La bêche lui paraît lourde ; la ferme ennuyeuse. Le travail qu’il peut fournir, peu prisé par le fermier, est payé en conséquence. Dans sa famille, le vide qu’il laissait a été rempli ; il ne retrouve plus sa place ; il n’est plus qu’un déclassé. Il se tourne alors vers les petites fonctions de facteur rural, de sergent de ville, de garde champêtre – ou particulier, d’employé des chemins de fer, etc. ; ses habitudes d’obéissance passive et de discipline le feront accueillir volontiers du gouvernement, des administrations ou des riches, et il représentera à merveille l’arrogance d’une part, la servilité de l’autre, qui donnent à la France, dans ses services publics, l’aspect d’une Russie. Il sera le limier le plus propre à pourchasser la liberté individuelle, dont le service militaire lui a enlevé le respect, en même temps que le sentiment. La France perd de la sorte annuellement 100,000 citoyens, qui vont grossir les rangs de ce peuple servile, dont l’armée est la pépinière, et qui, après avoir combattu par les armes la liberté à l’intérieur, continueront de faire peser sur les mœurs publiques la plus détestable influence.
Les efforts d’aucune ligue de la paix n’ont, que je sache, atteint les campagnes. Ici, en effet, la force des choses seconde les menaces des lois. Cette forteresse de l’ignorance est de tous côtés défendue. En dépit de l’esclavage de la presse et de l’autorisation de se réunir, la propagande se fait dans les villes par l’affluence des esprits éclairés ; l’atelier, le salon, sont des meetings permanents. Mais à la campagne la civilisation n’est représentée que par la villégiature des riches, anciens ou nouveaux grands seigneurs, par une bourgeoisie hostile à tout mouvement, et par l’ennemi même de la vraie civilisation, le prêtre. Les veillées à la ferme, toujours courtes, se passent en famille. On cause entre hommes, le dimanche ; mais l’entretien roule surtout sur le cours des blés, et, si quelque perturbateur de l’ordre admirable créé par la divine sagesse du czar, venait se mêler aux groupes, je vous laisse à
penser quel accueil lui serait fait par les autorités du
lieu, sinon par les groupes eux-mêmes.
Car la terreur des exagérations de 48, – ou plutôt des folies prêtées aux hommes de la seconde république française par leurs trop habiles ennemis, – si bien exploitée par la bourgeoisie et l’empire, dure encore au village, où le nom de partageux se répète toujours avec mépris. Dans un tel milieu, les impressions, extrêmement rares, sont durables. De nombreux préjugés y repoussent la république, préjugés qui pourraient être vaincus aisément, au grand jour de la liberté, par l’évidence du vrai,
mais que les mensonges officiels entretiennent.
Et cependant, c’est dans ce peuple des campagnes que reposent les solutions futures. C’est là que devraient se porter tous les efforts de la démocratie ; car là réside toute la force de l’ennemi et là seulement il sera vaincu d’une façon définitive. – L’ennemi, un ’homme ? – Non, un adversaire moins chétif et plus digne de haine, l’ignorance, le satan qui suscite et soutient tour à tour les représentants de l’arbitraire et du despotisme.
André Léo.
Dans, Les ETATS UNIS D’EUROPE, du dimanche 23 février 1868
L’EMPIRE DE L’HABITUDE.
Peu d’esprits sont capables de se dégager du poids dont la tradition les charge et de considérer les choses de ce monde comme si elles arrivaient d’un autre. C’est à nouveau cependant qu’il faudrait considérer le spectacle de la guerre, au milieu de ce que nous appelons pompeusement notre civilisation. Si nous voyions (au contraire du proverbe) les loups se dévorer entr’eux, cette férocité anti-naturelle nous paraîtrait monstrueuse, et nous nous hâterions de reléguer l’espèce parmi les plus
ignobles de l’animalité. Dans notre propre espèce, nous nous récrions d’horreur au sujet du cannibalisme, qui ne fait après tout qu’utiliser la destruction, et nous applaudissons en voyant l’homme se ruer sur l’homme ; nous parlons de gloire, d’honneur, quand des êtres intelligents,
aimants, réfléchis, se déchirent entr’eux et – ce qui est plus beau, sans là moindre animosité, sans le moindre intérêt – en y mettant même, ô chef œuvre de l’esprit ! de la courtoisie. – Tirez les premiers, Messieurs les Anglais.
Mais tout sur ce point a été dit. Compris, non. Il y a longtemps qu’au point de vue de la moralité la guerre a été jugée. C’est se condamner à être banal que d’en retracer l’horreur, et que d’établir sa parfaite imbécillité en tant qu’argument. Il en est de ceci comme de beaucoup d’autres vérités philosophiques et morales, tombées à l’état de redites avant d’avoir pu passer à l’état de faits. La guerre est un fléau ; qui vous contredit là-dessus ? personne. Seulement tandis qu’on s’empresse à soulager les maux inévitables : pestes, inondations, tremblements de terre, pour celui-là – le plus expéditif, le plus terrible, et qui est permanent – pour celui-là qu’on peut supprimer par un simple acte de volonté, on se contente de faire pieusement de la charpie.
Nous vivons dans un temps étrange : une ère nouvelle est commencée depuis déjà 78 ans. Cependant, comme firent les chrétiens d’abord, nous datons encore avec Rome. De nouvelles bases sont posées qui attendent un édifice nouveau, et sur les vieilles constructions un ouragan a passé ! Tout cela branle ; mais tout cela tient encore.. Un choc suffirait ; on ne le donne pas, on étaie. Sur la page à demi blanche du dogme nouveau, les ombres du passé luttent avec les lueurs de l’avenir. Dans ce jour indécis l’inertie domine et l’habitude règne.
L’habitude pour beaucoup remplace la foi et, comme elle, produit des miracles. Sur le fait de la guerre, c’en est un que de lui voir dominer jusqu’à l’amour maternel, ce grand, ce profond amour, plein d’élans cependant et d’inspirations soudaines.
– Madame, il y avait autrefois des mères qui portaient leurs enfants à l’autel de Moloch, afin que la tête de ces petits êtres y fut brisée et leurs entrailles répandues…..
Que de cris d’horreur !
– Doucement ; car voici Monsieur un tel, qui n’est pas un Dieu, et. qui dans tant d’années vous prendra ce fils que vous élevez pour un besoin analogue, et vous ne protestez pas.
Dans la famille, qui, malgré les imperfections et les vices, est la plus grande force de l’humanité, il n’y a rien de plus puissant que ce petit être, choyé, baisé, béni, pivot de toutes les pensées et de tous les soins d’une famille émue, auquel d’avance la jeune mère a fait le sacrifice possible de sa vie, à qui chaque jour elle continue de dévouer ses forces et sa santé, délices maternelles, paternel espoir, sourire de l’aïeule, rayon pour tous.
L’enfant est l’âme du foyer ; l’égoïsme des parents se déplace pour passer à lui ; tout l’avenir se bâtit pour lui ; tout converge en lui. Pour lui, souvent, de prodigue on devient avare ; la mère lui immole sa coquetterie ; le père lui consacre son ambition ; pour lui, les gens d’esprit braveront le ridicule ; l’austérité fléchira. On blâme ce qui lui nuirait ; on approuve ce qui le sert. Enfin, au bout de vingt ans de soins, de veilles, de dévouements journaliers, d’encens, de trésors versés autour de cette chère idole, quand se sont formés presqu’à la virilité ces membres d’enfant, quand ce cœur naïf est devenu un cœur d’homme, ouvert aux plus puissantes émotions de la vie, quand ce malléable cerveau est devenu par de longues études l’agent supérieur de la pensée, tout-à-coup, sur un ordre parti des lèvres d’hommes que l’on connaît peu, qu’on discute chaque jour, qu’on chasse quelquefois, – par suite d’évènements qu’on ne comprend guère, qui au dire de beaucoup auraient pu être évités, à l’égard même desquels, la plupart du temps, toute explication vous est refusée, il faut que cet enfant parte ; il faut qu’il aille se placer devant la gueule d’un canon et que ses membres soient déchirés et sa cervelle éparpillée, à la plus grande gloire d’un monarque et d’une nation.
Quand chaque année s’accomplissent par dixaines de mille de tels sacrifices, non sans larmes et sans gémissements, mais sans réflexion et sans révolte, n’est-ce pas à désespérer du sens et du cœur humains ?
Au contraire. Cela prouve que cette admirable créature, l’homme, est absolument capable de tout, dans la raison comme dans la folie. Il est capable de tout ce qu’il croit, de bon sens même. Il peut se vaincre, se dominer en toutes choses, se créer presque à nouveau, et il ne s’agit que de lui faire abandonner l’héroïsme bête pour l’héroïsme intelligent.
André Léo.
Dans, Les ETATS UNIS D’EUROPE, du dimanche 22 mars 1868
SOUSCRIPTION POUR OFFRIR UNE MÉDAILLE
A LA VEUVE DE JOHN BROWN.
Il y a quelques mois, une femme distinguée, Mme Gaël, du fond de l’Anjou, écrivait à l’une de ses amies à peu près ceci :
« Quelle loi puérile et arbitraire soumet en ce monde les pensées les plus justes, les manifestations les plus légitimes à une cause toute relative et de hasard, l’occasion ? A l’époque où l’on souscrivit pour offrir une médaille à Mme Lincoln, tout en m’associant de coeur et de fait à ce témoignage rendu à la veuve d’un homme si juste et si grand, je pensai avec tristesse qu’une autre veuve, dont le sacrifice avait été volontaire, le malheur plus grand, le dévouement complet, la veuve de John Brown, était oubliée. Comme toujours, l’initiateur cédait le pas à celui qui, achevant l’œuvre, récolte toute la gloire du succès.
« Et cependant quelle foi, quelle puissance, quel héroïsme dans le sacrifice de John Brown ! Il est de ces audacieux que soupçonnent volontiers d’un grain de folie ceux qui voient au point de vue du fait plutôt que du droit, et soumettent à des considérations de convenance, de temps et de lieu les décrets de la conscience. Il est de ces excentriques qui, au milieu du silence des autres hommes, se lèvent tout-à-coup pour dénoncer ce qu’on
ne veut pas voir, et troublent ainsi, avec une inconvenance ridicule, cet ordre si cher aux heureux, composé cependant, pour une grande part, d’injustices accoutumées et de silencieuses douleurs. John Brown, aussi bien que Lincoln, est homme de conscience ; mais dans cet ordre c’est un géant. Il savait que tout homme qui se lève pour une justice encore incomprise, incompris lui-même, et de plus insulté et honni, doit mourir ; mais il savait aussi qu’un tel sacrifice n’est jamais infructueux, que de pareils drames forcent à la réflexion l’humanité insoucieuse et que du haut d’un gibet l’on apercevrait bien mieux ce que la parole seule ne pouvait porter au-delà des murs de son humble ferme. Dans cette pensée, non-
seulement il donne sa vie, mais celle de ses fils ; et sa femme, et les jeunes femmes de ses fils acceptèrent ce dévouement et s’y associèrent avec un courage, une résolution qui ne se démentirent point dans les angoisses de la bataille, de la prison, du jugement, du supplice.
« Tout cela ne mérite-t-il pas qu’un sympathique hommage aussi aille trouver, consoler un peu ces cœurs humbles, qui, dans leur vie obscure et pauvre, se peuvent croire les seuls peut-être à garder le souvenir saint et
douloureux du martyr ? »
Mme Gaël ajoutait « Dès cette époque, je communiquai ma pensée à quelques amis ; mais ils me dirent : La souscription Brown nuirait à la souscription Lincoln ; attendez. Plus tard on me dit encore : Il faudrait une
occasion, quelque fait déterminant – l’occasion n’est pas venue, et j’ai toujours au cœur l’impression d’un si grand oubli. Aujourd’hui encore on me dit : Il est trop tard. Est-il donc jamais trop tard pour réparer une injustice ? Et cette haute consolation que porte la sympathie publique doit-elle manquer à celle qui a le plus souffert et le plus donné ?
« La personne à laquelle s’adressait Mme Gaël jugea comme elle qu’il n’était jamais trop tard pour réparer une injustice. D’autres pensèrent de même et l’on chercha à donner à cette idée la publicité qui devait la réaliser. Malheureusement, la presse, ayant bien d’autres affaires lui fit peu d’accueil, et le journal des ouvriers, la Coopération, fut le seul qui l’accueillit avec chaleur et qui, organisant une souscription populaire – à 10 centimes – publia les noms des souscripteurs et les adhésions immédiates de Victor Hugo, Schœlcher, Louis Blanc, etc.
Dix mille personnes déjà se sont unies aux généreux sentiments de Mme Gaël, mais le comité formé pour la direction et l’emploi de la souscription estime que la publicité donnée jusqu’ici a été trop restreinte. Ce comité
se compose, avec Mme Gaël et quelques autres dames, de noms connus dans la démocratie et dans la presse : Etienne Arago, Louis Blanc, Jules Barni, Ch. Chassïn, Victor Hugo, Joigneaux, P. Larroque, Evariste Mangin,
Laurent Pichat, Eugène Pelletan, Elisée Reclus, Schœlcher, Melvil Bloncourt et quelques-uns des rédacteurs et soutiens de la Coopération. Il a décidé de suspendre pendant un mois encore la décision à prendre au sujet
de la médaille, et de faire un appel aux journaux étrangers, comme aussi aux sociétés coopératives de l’Europe entière. C’est, en France, par ce groupe de travailleurs, qui cherchent leur affranchissement dans l’alliance de la science et de la fraternité, que la mémoire de John Brown a été le plus chaleureusement acclamée ; nous comptons sur leurs frères de Suisse, d’Angleterre, d’Allemagne et d’Italie pour s’unir à eux dans l’hommage rendu à ce héros populaire, dont la protestation et le martyre furent le point de départ de cette grande guerre américaine terminée enfin par l’abolition de l’esclavage. Dans une telle pensée, toute humanitaire, les démocrates de toutes les nations doivent se rencontrer et s’unir.
André Léo,
membre du comité
pour la souscription John Brown.
Adresser aux bureaux de la Coopération, rue Thévenot, 30, à Paris, les offrandes et les noms des souscripteurs.
Dans, Les ETATS UNIS D’EUROPE, du dimanche 20 septembre 1868
UN MALENTENDU.
Voici bien longtemps que l’on crie : La France se meurt. Beaucoup même n’hésitent point à affirmer qu’elle est morte. Et ce ne sont, en France même, – surtout en France peut-être, – que comparaisons incessantes de ce pays aux autres pays, toutes au désavantage du Français ; mais qu’il accepte, il faut le dire, avec une bonhomie, une humilité, faites pour racheter une bonne part de chauvinisme.
Quand ils consentiraient à signer leur propre décès, il n’en serait pas moins bon d’expliquer plus froidement et plus simplement l’état des choses. La France n’est pas morte parce qu’elle n’obéit pas à la voix de ces vieux républicains qui la menèrent un jour en braves gens, mais assez mal. Elle n’est pas morte, parce qu’elle ne partage pas les idées de tels ou tels, qui, remarquez bien, ne les lui ont jamais fait entendre. Car toutes ces lamentations et ces récriminations se passent en famille démocratique et lettrée, dans de petits cercles lumineux, hors de la foule ; et depuis l’immense révolution qui substitua le suffrage universel au pays légal, les procédés de la démocratie n’ont pas varié d’un iota. C’est toujours la discussion entre gens convaincus d’avance, la polémique du grand journal quotidien, rien de populaire.
Le vieux langage politique se compose de fictions déclamatoires. Tandis qu’au-dessous du théâtre où paradait pompeusement une poignée de marionnettes royales et princières, le peuple naissait, souffrait et mourait, sans volonté comme sans histoire, l’historien n’en répète pas moins la nation, le peuple, et fait s’émouvoir et se passionner pour des événements qu’elle ignore cette collectivité passive. Dans les villes seules le peuple agissait, quoique souvent au hasard ; à la guerre, aux lueurs de la bataille, la silhouette populaire parfois se détachait en traits, vigoureux ; mais ce qu’on appelle la nation, couchée sur le sillon maigre où s’épuisaient ses forces et qui ne satisfaisait pas sa faim, éparse de hameaux en hameaux, n’avait rien de commun que sa misère, ne savait rien de son propre sort que cette misère, et ne composait en aucune manière une collectivité animée de passions communes.
La Révolution illumina ces ténèbres de grands éclairs ; mais elle n’eut pas le temps de fonder, par l’habitude, par l’éducation, la vie publique ; ce que les masses rurales comprirent seulement de ses bienfaits, c’est que la terre leur était donnée. Bienfait immense et ardemment goûté ; mais la reconnaissance qu’elles en auraient dû garder fut combattue et presque étouffée par les calomnies anti-révolutionnaires des prêtres et des bourgeois. 1848 n’a laissé dans les masses qu’un souvenir l’augmentation subite de l’impôt ; qu’une idée : celle des partageux, et qu’un fait : le suffrage universel, dont elles ne savent trop que faire. Le livre et le journal leur sont aussi étrangers qu’auparavant. Du bruit qui se fait au ministère de l’instruction, si libéral en projets, il n’arrive rien jusqu’à eux. Les écoles de hameau sont dans les décrets de la Chambre ; elles y restent. Quelques cours d’adultes dans les villes et bourgs ne vont pas loin. Il est si peu dangereux de savoir lire quand on n’en a pas le temps, quand les livres manquent ! Les opinions politiques du paysan s’appuient donc nécessairement sur le temps qu’il fait, sur le prix des grains, des bestiaux, et – qu’on ne l’oublie pas – sur l’état de l’impôt. Ce dernier point contient – au rebours des 45 centimes – toute la politique révolutionnaire future. – Pas d’indignation ! Il siérait mal de demander à qui n’a rien reçu.
Telle est la nation actuelle ; elle est si peu morte qu’elle vient de naître. Les 6 millions de la présidence, les 8 millions de l’empire ont été les premiers faux-pas d’enfants, subitement arrachés à leur maillot, qui marchaient pour la première fois.
Que la bourgeoisie se sente humiliée ; qu’elle porte en rougissant le bât mis sur ses épaules par ce malotru, ce paysan, si mal élevé par elle, peut-être n’est-ce pas si mal fait. Mais que les penseurs se désespèrent, c’est trop d’impatience. Il faut voir la situation telle qu’elle est, crise inévitable, dont la solution peut être hâtée, non par des clameurs, mais par des soins courageux, patients. Sur ce point, si les nations se comparent entr’elles, elles reconnaîtront qu’elles ont toutes beaucoup à faire. Partout l’instruction est insuffisante partout il la faudrait étendre et renouveler ; partout le loisir manque à l’homme de travail pour cultiver son intelligence ; partout l’énigme sociale, encore obscure, pèse sur les nations libres comme un despotisme inévitable, doublant l’autre ailleurs. Mais au-delà de ces épreuves tout n’est qu’espérance. C’est la dernière accession des races à la vie commune, et si nous souffrons actuellement de cette solidarité dans les ténèbres, nous savons avec certitude que, dans un temps plus ou moins proche, et que nos efforts peuvent avancer, nous en jouirons en pleine lumière. Ne parlons donc pas de mort, mais de vie.
André Léo.