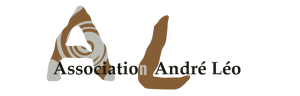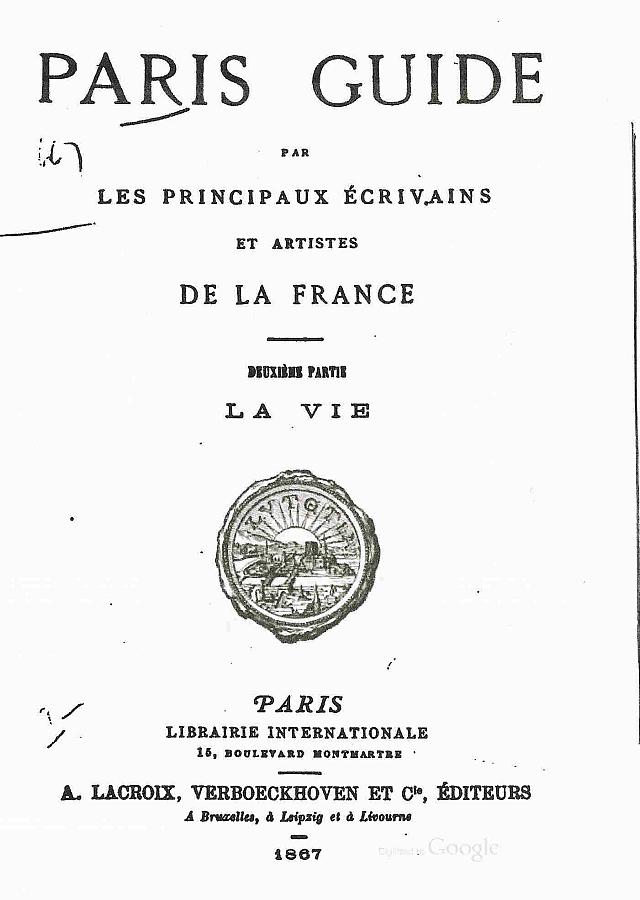LA COLONIE AMÉRICAINE
ANDRÉ LÉO
Quand vous parcourez les Champs-Elysées, de la place de la Concorde à l’arc de l’Etoile, ou les avenues qui y convergent, du côté de la Madeleine, dans tout le quartier Saint-Honoré, vers le parc Monceaux, vous rencontrez fréquemment des femmes richement parées, des hommes à barbe blonde, à l’air calme et doux, des jeunes filles à la démarche vive et décidée, de beaux enfants aux cheveux bouclés, dont la physionomie est à la fois pleine de candeur et d’assurance. Tous ces individus, isolés ou groupés, vous offrent à peu près le même type : visage fort, par rapport à la boîte crânienne-, yeux gris perçants, traits mobiles, souvent agréables, quelquefois beaux. Rien de la raideur britannique, et même, avec le type anglais, quand il se présente, une physionomie tout autre plus franche et plus simple. Ce sont des Américains, vivant à Paris, soit dans leur propre home, en famille, soit dans les pensions du quartier.
Toutes les nationalités, d’ailleurs, se rencontrent et se heurtent dans ce quartier neuf aux belles avenues et voisin du bois. Mais il y a prédominance évidente de la langue et des coutumes américaines et anglaises, ainsi que le démontrent les enseignes des pharmacies, des magasins, des restaurants, des pensions, et les pâtisseries spéciales qui étalent, derrière leurs vitres, cakes, pies, puddings. Cependant, si, dans tous ces lieux, l’unité de langue et la conformité d’habitudes réunissent Anglais et Américains, les deux sociétés se fréquentent peu. L’anglophobie, comme sentiment national et populaire, est peut-être encore plus ardente aux États-Unis que parmi nous.
C’est par dizaines de mille que l’on compte à Paris, cette année, les Américains, en dehors môme des commerçants venus pour concourir à l’Exposition. En tout temps, ils forment ici une colonie assez nombreuse, composée de deux éléments : l’un de passage, l’autre stationnaire ; celui-là simple visiteur, celui-ci venu avec l’intention de séjourner deux ou trois années. On pourrait même compter en troisième lieu un certain nombre d’Américains, acclimatés à Paris comme dans une. nouvelle patrie, et alliés, pour la plupart, à des familles françaises.
La population résidente se compose généralement du corps diplomatique, des banquiers, de familles venues pour l’éducation de leurs enfants, et d’artistes avides d’étudier les chefs-d’œuvre de nos musées. On accuse le peuple américain d’être dépourvu de sentiment artistique ; ce jugement, porté sur un peuple nouveau, qui devait, avant tout, se préoccuper de travail et d’industrie, est trop hâtif. Les artistes américains en appellent, et déjà leurs efforts et leurs ambitions font présager le développement de cette noble et précieuse faculté humaine, qui existe en germe chez tout peuple comme chez tout homme, mais qui exige certains loisirs et certaine éducation de l’esprit. Ce qu’on peut espérer de l’art américain, on le saura cette année, puisque beaucoup d’artistes ont envoyé leurs œuvres à l’Exposition. On cite déjà, parmi eux, MM. Woodberry Langdon, peintre d’origine française ; May, auteur d’un King Lear qu’on dit fort beau ; Rogers, dont les sculptures patriotiques reproduisent les héros et les faits de la dernière guerre ; Hill, dont le pinceau nous apporte les grands paysages californiens.
Dans l’école française, les Américains, rangés par nos rapins au nombre des épiciers de l’époque, recherchent surtout les tableaux de genre. Le peintre Couture a particulièrement leur faveur, et l’on cite un de ses tableaux que vient d’acquérir un Yankee, moins épicier peut-être que malicieux. Jugez-en : c’est une courtisane conduisant son char auquel sont attelés banquiers, diplomates et autres hommes importants formant l’élite de l’ordre social. Emporter là-bas cette cruelle satire de la vieille Europe, voilà qui est peu généreux, des Américains. Faudra-t-il envoyer de nos peintres à Washington !
Le quartier général des Américains de passage est le Grand- Hôtel, sur le boulevard des Italiens. Cet établissement, par sa position centrale, ses aménagements intérieurs, son luxe et son confortable, jouit d’une réputation colossale de l’autre côté do l’Océan. On part de New-York pour le Grand-Hôtel ; c’est là qu’on prend terre, qu’on s’oriente, qu’on s’informe, et que, suivant ses moyens ou ses projets, on s’y installe pour quelques mois, on passe à quelque autre hôtel, ou pension, ou bien on loue un appartement pour vivre chez soi. Pénétrez dans la cour, montez les escaliers du portique et prenez place dans la Teste et belle salle de lecture, en face du portail. De minute en minute, les voitures qui, sans cesse, arrivent et s’en vont, amèneront sous vos yeux dix Américains pour un insulaire. Du Grand-Hôtel, le touriste se porte facilement sur tous les points où l’appellent ses besoins et sa curiosité. La première visite est pour son banquier, soit rue de la Paix, chez Bowles et Drevett, soit rue Scribe, Tucker ou Monroe, soit chez Norton, rue Auber. Depuis la guerre, la maison Rothschild se demande naïvement ce qu’est devenue son excellente clientèle américaine. Elle est ailleurs, monsieur de Rothschild ! Les sympathies naturelles entre banquiers et planteurs s’étaient chez vous trop accusées pour que le Nord ne vous gardât pas rancune. Et quant à vos clients du Sud, ainsi que leurs fortunes, ils se sont évanouis. C’est le Nord, en tout temps d’ailleurs plus actif et plus voyageur, qui afflue surtout à Paris, il ne fait pas toujours bon écouter les inspirations de son cœur, monsieur de Rothschild, et les banquiers, en ce siècle, doivent se méfier de leurs sentiments.
Le cabinet du banquier américain est, à beaucoup d’égards, un bureau de renseignements où chacun va s’informer et porter son mot. On y trouve, d’ailleurs, les journaux de la patrie, et enfin ce renseignement, le premier, le plus universellement réclamé, surtout autrefois, le taux de l’or ! Aujourd’hui, on vous donne 100 pour 135 ; la perte est peu forte mais, au temps de la guerre, qui voulait, dépenser mille francs à Paris devait recevoir de New- York, en papier, tout prés de trois mille francs. Forcément, on se restreignait. Maintenant souffle une brise plus heureuse, sous laquelle s’enflent les lés de satin et les cachemires et refleurissent les gracieuses créations des Laure, des Ode et des Leroy. Les joailliers de là rue de la Paix reçoivent de nouvelles visites ; on rêve et l’on peut exécuter des toilettes splendides ; les soirées se multiplient, et la vie mondaine reprend toute son ardeur.
Aussitôt son arrivée à Paris, la partie féminine, qui domine par le nombre aussi bien que par l’influence dans les conseils américains, se répand chez les fournisseurs en renom. On a hâte de se procurer, à prix relativement réduit, ces modes parisiennes que le custom-house (la douane), là-bas, élève à dès prix exorbitants. On court chez Lucy Hoquet, chez Alexandrine ; on va commander ses robes chez Vignon, chez Wolff, chez madame Roger ; on visite les magasins de nouveautés. Vêtues enfin des modes les plus riches et les plus nouvelles, on remplit une calèche pour aller au bois ; on court à l’Opéra, aux Italiens, aux divers spectacles, à l’Ambassade. On s’inscrit pour se faire présenter aux Tuileries et l’on commande une toilette de cour.
Ces républicains !... D’abord, je vous le dis en confidence, et vous le reconnaîtrez avec moi tout le long de ce récit, ces républicains sont fort amoureux de pompes mondaines ; ensuite, ils n’ont pas contre les monarques les... préjugés que vous et moi nous pourrions avoir. Cela vous étonne ! Mais songez donc : leur sentiment à cet égard est si désintéressé ! Les monarques d’autrui ne les choquent ni ne les effrayent. Ce sont d’ailleurs des touristes, qui veulent tout voir et surtout avoir tout vu. De retour dans ses foyers, la famille américaine devra pouvoir dire qu’elle a été présentée, qu’elle est allée à la cour. Il serait humiliant de n’avoir pas eu ce privilège. Puis, venus pour connaître les curiosités européennes, peuvent-ils négliger celles qui sont le plus étrangères au nouveau monde ! L’ardeur même qu’ils y mettent s’explique par les changements de décors si fréquents en notre siècle. Est-on jamais sûr de retrouver les mêmes spectacles quand on reviendra !
Chaque mois, donc, le ministre des États-Unis est tenu de présenter, sur simple demande, une fournée de quelque cent de ses compatriotes. Pourquoi pas ! Ni vilains, ni seigneurs, tous Américains. Les préférences ne sont pas permises, sans quoi le ministre n’aurait qu’à se bien tenir. Ces démocrates à l’étranger n’ont point renoncé à leur souveraineté et ne sont pas sans influence quant au choix de leurs agents. Et voilà comment cette envahissante démocratie s’impose et pénètre dans les sanctuaires.
Il faut avouer cependant qu’un certain nombre d’Américains s’acclimatent aux splendeurs des cours, et qu’à Paris en particulier plusieurs sont devenus les hôtes habituels des résidences impériales. On cite de jeunes personnes dont les hardiesses et les excentricités feraient pâlir celles mêmes qui ont pris leur source aux bords du Danube, et dont les intrépides complaisances accepteraient, dit-on, dans les divertissements et spectacles, les rôles les moins voilés. Mais nous ne pouvons écouter les chuchotements de cette chronique maligne qui, américaine ou non, a pour vraie patrie la terre entière, sans quoi nous serions obligés de parler aussi du peu de hauteur des corsages américains. D’abord cet usage évidemment, ainsi que la Bible et d’autres coutumes, est de pure tradition anglaise’, et puis une circonstance atténuante à faire valoir, c’est que les flots de l’Océan nous apportent des épaules tout autrement belles que ne font ceux de la Manche. Un tel détail, d’ailleurs, il faut en convenir, n’a rien de bien caractéristique, et peut-être n’est-ce point aux compatriotes de nos Parisiennes à le relever !
Les salons du ministre des États-Unis sont naturellement le point central de réunion de la société américaine à Paris. Mr et Mme Bigelow, autrefois, recevaient tous les mercredis dans la journée, mais ne donnaient de soirées qu’irrégulièrement et sur invitation, ce qui était jugé par la colonie peu suffisant. A présent, le général Dix, outre ses réceptions du jour, chaque mercredi, reçoit tous les samedis dans la soirée. L’aspect et le ton de ces réunions est à la fois moins solennel et plus froid que nos réunions françaises. L’obligation d’être présenté pour pouvoir s’adresser la parole existe dans cette société démocratique aussi bien qu’en Angleterre, et, d’un autre côté, le langage et les allures américaines ont l’empreinte naturelle du laisser-aller et de la franchise, sans exclusion peut-être d’un peu de rudesse.
Mais, sous ce rapport, les Américains, — certains, veux-je dire, — protestent et demandent à ne point être jugés en masse à Paris. Au coin de leurs lèvres glisse, en même temps, un de ces sourires qu’on appellerait ici faubourg Saint-Germain, et avec une intonation de même provenance, ils laissent tomber le mot : Shodey, presque intraduisible comme sens exact, et qui signifie à peu près ceci : « L’argent étant le nerf des voyages, ceux des citoyens de l’Union qui viennent à Paris doivent être et sont, en général, des riches, mais non pas des riches à la mode européenne, — qui s’en va d’ailleurs, — c’est-à-dire des aristocrates de manières et d’éducation. Là-bas, l’élaboration incessante de cette triple fournaise du commerce, de l’industrie et de la spéculation, si elle produit énormément, conserve peu ; aussi les riches, en Amérique, sont-ils surtout des enrichis, race connue dans le monde et à peu près la môme sous tous les climats. Toute élaboration, en outre, a ses scories. » Tel est le fait économique et social auquel font allusion le mot dédaigneux et le dédaigneux sourire. Où l’aristocratie n’existe-t-elle point !
Assurément, ce n’est ni en Amérique, ni parmi les Américains de Paris qu’elle est inconnue. Si vous désirez être présenté chez leur ministre ou dans quelqu’un de leurs salons, le luxe en vînt-il du pétrole ou fût-il fait de shodey, n’oubliez pas vos aïeux. Certain littérateur de mes amis, honorablement connu, fat assez surpris, en Usant sa lettre d’introduction, de s’y voir recommandé bien moins pour lui-même que pour son grand-père, illustration départementale, qui importait aussi peu que possible aux États- Unis. Ce fait n’est point isolé ; il vient d’une loi bien plutôt humaine que nationale, qui consiste à priser surtout ce qu’on n’a pas. L’Américain, peuple sans ancêtres, et, en tant qu’individu parvenu le plus souvent, tient naturellement en haute estime l’illustration de la race. C’est à qui se vantera d’appartenir aux premiers fondateurs des colonies, et là-bas môme on en est arrivé à rire de ces prétentions. La Virginie, colonisée par les gentilshommes cavaliers, partisans des Stuarts, est un des États où l’on ait le plus de prétentions à la noblesse ; aussi la phrase sacramentelle pour la présentation de tout Virginien est-elle : appartenant aux premières familles de l’État. — On n’a jamais vu les secondes, ajoute le dicton malin.
Quant aux titres nobiliaires, si vous en possédez, oubliez-les moins encore, et soyez sûr qu’une fois déclarés, on n’oubliera jamais de vous les donner. Ces titres vous attireront de doux regards et jetteront leur poids dans la balance où l’on pèsera vos mérites, si vos vœux se portent jusqu’au mariage près de ces blondes beautés, dont la plupart ont des dots californiennes ; car ces jeunes républicaines estiment qu’une couronne ducale sied ù merveille sur des cheveux blonds et que le titre de comtesse est parure à compléter la toilette d’une élégante. Aussi se conclut-il ù Paris nombre d’alliances entre la France d’autrefois et l’Amérique d’aujourd’hui. On parle même en ce moment d’une brillante union de ce genre qui, au grand scandale de la colonie, aurait été ménagée à la mode française par intermédiaire. Vous le voyez, si aristocrates qu’ils veulent paraître, ces braves Américains gardent encore de beaux préjugés. Ils ne comprennent pas qu’on se marie autrement que par soi-même, et à la suite d’une connaissance mutuelle.
Donc, nous disions, chroniqueur indiscret, que parmi ces belles robes traînantes de taffetas, de satin, de velours, qui remplissent au bois les calèches, émaillent nos boulevards et se déploient majestueusement dans les salons de la rue de Presbourg ou dans ceux des Tuileries, il en est un certain nombre, si fraîches soient- elles, qui viennent des sources jaillissantes du pays de l’huile. Peu importe, et si, comme il est tout naturel, la chose doit être assez mal vue en pays démocratique, h nos yeux, cela ne tache point. Nous voulons dire seulement que, dans le tourbillon commercial des banques de New-York, des districts houillers, des mines de l’Ouest ou des sources de Titusville, si l’on a fait quelque opération heureuse, quelque grand coup de filet, aussitôt le désir des young ladies s’enflamme ; il faut voir l’Europe et l’on part. C’est que, pour tout bon Américain, voir l’Europe est un désir plus ou moins accusé scion les circonstances, mais toujours latent. On affecte bien de la mépriser, cette vieille Europe ; mais elle n’en est pas moins le pays des aïeux, le chaînon qui relie ce nouveau peuple à la tradition humaine et, si riche soit-il d’avenir, il a, comme tout humain, besoin du passé. Hors sa liberté, en effet, hors sa richesse, tout lui vient de l’Europe : religion, langue, littérature, science, arts, souvenirs et le sang même qui rougit ses veines. On publie en Amérique, énormément de livres et de journaux ; mais les classiques anglais et français, sans exclusion des. ailleurs modernes., composent le fond de toute bibliothèque sérieuse, et tous ceux qui, dans cette civilisation adolescente constituent le monde lettré, ont les yeux tournés vers l’Orient.. Londres et Paris enfin sont pour le Nouveau Monde ce que furent pour nous, à l’époque de la Renaissance,. Rome et Athènes. Soit dit sans comparaison fataliste : si éclatants que soient les progrès de la jeune Amérique, si affligeants que soient nos reculs, nous croyons à des vitalités immortelles chez tous les peuples, et nous ne croyons pas au plan préconçu de l’histoire, ni à son plagiat éternel. Le droit individuel a, comme une hache, tranché le cercle théocratique, aristocratique et monarchique où la vieille Clio roulait son char, et les deux, bouts écartés retrouvant leur sève, vont désormais s’allongeant dans l’infini.
Quant aux familles, établies à Paris pour l’éducation de leurs enfants, c’est la musique et la langue française qu’elles ont surtout en vue. Cependant, l’instruction des jeunes filles américaines est ou paraît fort complexe ; celle des garçons, beaucoup moins, car en général chacun d’eux, ayant sa fortune à faire lui-même, se jette de bonne heure dans le mouvement commercial. Mais la jeune fille, soit qu’elle se destine à l’enseignement, soit qu’elle travaille sans autre but que le développement et l’ornement de sa personne, se livre à des études que l’on traiterait chez nous de pédantesques. Ce sont elles, au rebours, qui apprennent le latin, l’algèbre, la géométrie. Elles aborderaient même, sans aucune frayeur, des sciences plus spéciales ; mais regardez-les et rassurez-vous : le soin de leur toilette n’en a pas souffert, et ces méchantes accusations de disgrâce, lancées contre les femmes crudités, tombent devant l’étalage de leur luxueuse frivolité. Voyez, si les flots de soie, de gaze, de dentelle qui les entourent en sont moins abondants ; si les détails de leur mise témoignent d’une moindre science féminine, si l’ensemble a moins de fraîcheur ? Il serait plus difficile de reconnaître si l’érudition intérieure est de même force et quelle somme de capacité recouvrent les étiquettes du programme scolaire ;, mais un fait incontestable et incontesté, effet en sens inverse de la même cause qui agit chez, nous, c’est la supériorité de la femme sur l’homme dans le Nouveau Monde. Tandis qu’en général, dés l’âge de quatorze ans, le jeune Américain cesse toute étude pour entrer dans les bureaux de son père ou de quelque autre négociant et consacre toute son intelligence aux spéculations commerciales, la jeune fille poursuit ses études, les fortifie souvent par l’enseignement, et, célibataire ou mariée, a toujours de longues heures à donner aux exercices de l’esprit. Tous ceux qui connaissent l’intérieur des Américaines parlent de la lecture comme d’une de leurs principales occupations. On les voit, en outre, se presser aux cours littéraires et scientifiques ; mais ce qu’on pourrait leur reprocher, c’est, jusqu’ici, de ne pas se servir de cette supériorité dans le sens de leur dignité et de leur indépendance.
La théorie qui fait de la femme une reine dans les fers, gouvernant par la grâce du charme et de la beauté, est en pleine floraison, de l’autre côté de l’Océan. Le premier devoir et le premier orgueil d’un mari américain sont d’assurer l’oisiveté de sa femme et de suffire aux dépenses de sa toilette. Il y a aux États-Unis beaucoup de femmes fonctionnaires, soit dans l’enseignement, soit dans les services publics, tels que les postes, les télégraphes et même .les bureaux des ministères. Ce sont presque toutes des célibataires, état fréquent dans la nouvelle Angleterre, qui lutte avec l’ancienne pour l’excédant de population féminine ; elles donnent. leur démission quand elles se marient. « Je ne souffrirai pas que ma femme travaille », tel est le mot d’orgueil masculin qui, par contre, est le mot d’une dépendance. Mais, sauf un pp.rti d’émancipation qui s’est formé sous l’inspiration de miss Staunton, les Américaines s’arrangent à merveille de leur rôle d’enfants gâtées, et, tout aussi mondaines que nos femmes d’Europe, elles ne s’attachent à les dépasser que par le luxe, dont elles raffolent. En sorte que, malgré cette belle liberté qu’ont les jeunes gens et les jeunes filles de se voir et de se connaître, nous avons bien peur que l’amour pur, détaché de tous frais d’établissement et do tout étalage de corbeille, n’ait encore obtenu dans aucun pays du monde ses lettres de haute naturalisation.
Les mœurs américaines, on le sait, accordent aux jeunes filles Ri liberté la plus entière. Chargées elles-mêmes de leur propre vertu, de leurs propres intérêts, elles n’en sont que mieux préservées. Instruites des dangers de la vie, elles sont capables de les braver ; mais il faut dire que cette tâche leur est facile, grâce au respect dont les hommes les entourent. Une jeune personne peut traverser d’un bout à l’autre tout le territoire de l’Union sans avoir à craindre ni honteuses poursuites, ni même le moindre propos inconvenant. Aussi la jeune fille américaine se distingue-t-elle vivement des nôtres par son seul aspect. Son costume lui- même a quelque chose de plus dégagé. Ce sont elles qui, les premières, ont adopté les petits chapeaux masculins, posés sur le front et laissant par derrière à découvert ces bottes de cheveux dont, par exemple, nous ne saurions, pas plus que nul autre, à notre époque, certifier la race et la nationalité. Elles portent volontiers les jupes courtes et découpées, chargées d’ornements de jais, les hauts brodequins ; les suivez-moi de toutes couleurs s’étalent à flots sur leur nuque. Si elles sont dépourvues de ces grâces timides, uniforme obligé de nos jeunes filles, elles ont en revanche les grâces de la liberté. Elles ne cloutent de rien, ni surtout d’elles-mêmes. Elles marchent en filles d’une race conquérante et qui se fait elle-même sa place au soleil. Et si parfois cette disposition s’étend, disent les médisants, jusqu’à l’arrogance, on sait qu’outrer ses qualités est un défaut de tous les pays.
Leur assurance. en outre, nous l’avons dit, tient à l’admirable conduite des hommes de leur nation. Pourquoi n’iraient-elles pas ainsi tout droit devant elles, confiantes, quand elles savent trouver, partout où daignera se poser leur petit pied, une place nette et sans souillure ! Cependant, les choses ont si peu d’équilibre en nos mondes, fussent-ils nouveaux, qu’en vertu de ce système, c’est l’homme dont la réputation et la sécurité se trouveraient en péril, par les attaques impunies d’une faiblesse trop protégée. Que de doux regards l’attirent, qu’il se laisse charmer par de délicieux sourires, qu’il s’oublie trop longtemps dans une attachante conversation, le malheureux est perdu. Les apparences l’accusent, et il se verra condamné à l’amende, ou au mariage, par tous les tribunaux de l’Union.
Mais, en vérité, aux yeux de ces gens-là, Paris doit sembler le monde renversé ! Tout à fait. Les mères américaines se plaignent vivement du peu de sécurité et de vrai respect accordés aux femmes parmi nous, de la galanterie des Français et des indulgences de l’opinion pour ce cas pendable. Elles ont raison. La marque la plus sûre de la dignité d’un peuple est le respect qu’il porte à sa propre nature, aux conditions de sa vie. L’amour est la licence partout où manque la liberté, c’est-à-dire le respect de soi ; et malgré les terreurs de ceux qui réduisent la vertu à ce hasard, ou plutôt à cette négation : l’impossibilité de mal faire, la chasteté vraie a pour sœur la liberté.
Elles se scandalisent encore à Paris de bien autre chose, ces mères de famille américaines, car elles paraissent avoir la ferme conviction que, dans l’union conjugale, aucun autre tiers que l’enfant ne doit être admis. Les jeunes filles, de leur côté, s’étonnent et s’indignent de l’étroite surveillance à laquelle sont soumises les jeunes Françaises. Bon gré mal gré toutefois, elles ont jugé convenable de faire quelques concessions sur ce point, et se font escorter d’une bonne lorsqu’elles sortent sans leurs parents. Étrange garantie, assurément, et faite pour inspirer une triste idée de notre bon sens en même temps que de la dignité de nos mœurs. Mais, ô young ladûs, vous nées sur une terre où les influences monarchiques n’ont jamais fleuri, pourquoi vous soumettre à ces honteuses pratiques de geôle et d’espionnage ! Ne vaudrait-il pas mieux nous donner l’exemple de votre dédain pour elles et enseigner à nos femmes les « meurs de la. liberté ! Après tout, Paris n’est pas une forêt, et il suffit d’un coup d’œil de mépris ou d’un haussement d’épaules, du silence môme, pour laisser à la honte de sa tentative un flâneur, trop artiste ou un. impertinent gandin. Est-il donc vrai qu’à défaut d’autre tyrannie, le respect de l’opinion, quelle qu’elle soit, en Amérique, est un joug.
On assure qu’en revanche de cette soumission momentanée, les jeunes Américaines, une fois de retour dans leur patrie et rendues à leur complète liberté, ne sont plus tentées de revenir à Paris. Là-bas, elles vont, viennent à leur caprice, abordent fraternellement les jeunes gens, se promènent avec eux, flirtent (1) avec, fureur, sans jamais avoir à rendre compte de leurs actes ni de leur temps ; maîtresses absolues d’ailleurs dans ta Maison de leurs. mères. A Paris même, sur ce dernier point, on ne sauve guère que tes apparences. Plus l’enfant grandit. plus sa liberté s’affirme, s’étend et déborde. La sœur aînée prend sur les plus jeunes les droits d’une mère, et à mesure que le jeune astre monte sur l’horizon, la mère, humblement, s’efface. Autre excès, peut-être. Sans doute. Mais ce peuple, tige nouvelle plantée dans un sol nouveau, croit aux forces de la jeunesse et de l’avenir. C’est en cela que réside son originalité ; c’est en cela que réside sa force.
(1) Le mot flirt indique le manège de la coquetterie.
Tandis que les jeunes Américaines aiment peu follement le séjour de Paris, il n’en est pas ainsi des jeunes hommes. — Pourquoi cette différence ? Elle contient bien des choses, tant à propos des nationalités particulières que de la nature humaine en général. Souvenez-vous qu’aux États-Unis, si l’on conçoit de la-même manière qu’ici la nature de l’homme et celle de la femme, les conséquences tirées de cette conception sont absolument opposées. Ici, la faiblesse livrée à la force ; là-bas... le contraire ou à peu près. En Amérique, la séduction honnie et punie ; en France, vice aimable et glorifié. Or, quel que soit le rapport des peuples avec leurs institutions, on ne peut nier la force de l’exemple, de l’occasion, ni ces ferments qui semblent exister dans l’humanité à l’état d’infusoires, toujours prêts à fournir, sous des conditions favorables, leurs malsaines générations. Enfin, l’art, l’opéra, la danse... Paris offre tant de plaisirs et tant de beautés !
A propos de danse, l’école de M. Perrin, place Gaillan, est très-fréquentée par les jeunes Américains. Mais les figurantes sont Françaises.
Si vous désirez diner de compagnie avec les dollar » de l’Union, rendez-vous chez Peters, boulevard des Italiens. Mais ce plaisir vous coûtera cher, et vous pourriez l’obtenir plus facilement chez Philippe, rue Montorgueil, où beaucoup de Yankees, plus economes et connaissant leur Paris, vont déguster les primeurs des Halles centrales. Vous en rencontrerez encore en grand nombre à la brasserie du Faubourg-Montmartre ; mais s’il vous plaisait de goûter un de leurs mets nationaux, allez rue Godot-de-Mauroy, vous faire servir chez Chariey des buckwheat cakes. Bien qu’ils apprécient la cuisine française, certaines habitudes de la patrie restent chères aux Américains ; les pommes de terre et le riz bouilli continuent à remplacer le pain sur leurs tables et de temps à autre, si l’on reçoit, des membres de sa famille restée-aux États, Unis, quelque envoi des excellentes farines de l’Ouest, maïs et froment, les ménagères se mettent à l’œuvre et bientôt l’on savoure avec tout l’attendrissement que les sensations de l’estomac peuvent ajouter aux émotions du cœur, des gâteaux ou puddings, dont l’excellente saveur rappelle plus vivement les souvenirs du home.
Puisque nous en sommes à parler ménage, — chose regardée, depuis le siècle de Louis XIV, comme peu poétique eu France, mais tenue pour essentielle en Amérique, — nous signalerons les réclamations qui s’élèvent cette année dans la colonie contre la cherté du vivre à Paris et surtout contre la domesticité parisienne. Les deux questions môme se confondent, à ce qu’on assure, et c’est de quoi surtout l’on se plaint. Toutefois, nous aurions peu prévu ce scandale, nous étant laissé dire que, chassée de ses foyers par les exigences et la mauvaise volonté du serviteur, devenu de plus en plus rare, la famille américaine avait déserté le home pour le board, la pension autrement dit. Même, nous comptions paresseusement sur nos voisins de l’autre côté de l’Océan pour résoudre les premiers ce désespérant problème, qui marche de plus en plus vers une solution forcée, et voilà que nous serions, au contraire, les plus mal servis, et que l’immoralité de nos cuisinières, s’ajoutant à celle de nos gandins, appellerait sur notre Babylone l’anathème des cieux bibliques !
Peut-être le mal vient-il pour une part de l’opinion généralement répandue à Paris que les Américains n’estiment les choses qu’en raison de ce qu’elles coûtent. Si quelqu’un d’eux, en effet, vous demande le meilleur fournisseur en tel genre, lisez le plus cher, et répondez en conséquence. Et si vous leur recommandez quelque professeur de mérite obscur, ayez soin de prévenir celui-ci qu’il se garde bien de ne pas demander un prix déraisonnable, sous peine d’être congédié. Bons Américains, n’ayez peur : le Parisien connaît votre humeur et vous servira à souhait. Dans le petit marchand même, qui roule par les rues sa charrette, il y a l’étoffe d’un philosophe et d’un diplomate. Son regard, au moment où vous l’abordez, a déjà pris votre mesure de pied en cap ; ses prix sont des jugements où votre fortune, votre nationalité, vos prétentions, vos habitudes, votre caractère, se trouvent compris. Il vous enlacera soit par la vanité, filet cosmopolite, soit par la pitié, la persuasion, l’éloquence, l’effronterie, la peur de ses quolibets, le besoin de son estime. Il fera pour un sou, libéralement, ce que font pour des francs, mais avec plus de banalité, les fournisseurs en habit noir, auxquels vous avez surtout affaire.
Quoi qu’il en soit des inconvénients de la capitale française, voici le proverbe qui a cours aux États-Unis : « Quand les bons Américains meurent, ils viennent revivre à Paris. »
Est-il rien de plus touchant, de plus énergique et de plus flatteur ! Mais, sentiment à part, ce mot nous semble, delà part d’un peuple biblique, hérétique terriblement. Quoi ! Paris substitué comme paradis au séjour des justes ! son tourbillon aux assoupissantes béatitudes ! ses spectacles à la contemplation du Saint des saints et les chants des divinités de l’Opéra aux éternels cantiques des bienheureux ! Qu’avez-vous fait de l’esprit chrétien, ô Américains de Paris !
N’allons pas trop loin, toutefois, sur l’autorité de ce proverbe, car si vous aviez le malheur de n’appartenir à aucune des communions religieuses dûment constituées, en ce siècle plein de foi, il faudrait vous garder très-soigneusement de révéler le fait dans aucun des salons de la société américaine. Soyez juif, surtout si vous êtes baron ; soyez mahométan : pour peu que vous fassiez partie du corps diplomatique, vous serez bien accueilli ; choisissez entre les mille sectes qui pullulent en dedans ou en dehors du protestantisme, il y en a de mieux portées les unes que les autres : mais on ne fera pas d’objection à votre choix. Seulement, ayez un fétiche ; autrement, vous passeriez pour un personnage... non pas dangereux précisément ! — on n’a peur de rien en Amérique, — mais immoral peut-être, et, à coup sûr, inconvenant, te qui est bien pis. Cette exigence, d’ailleurs, si elle est très américaine, rentre dans les traits généraux qui distinguent l’espèce, du détroit de Magellan au détroit de Lancaster, et du cap de Bonne-Espérance au cap Sévéro. Elle tient à l’habitude humaine de confondre le mot avec la chose et de tenir pour dépourvus d’idéal ces vrais croyants qui, défiants d’eux-mêmes et confiants en l’inconnu, n’adorent pas sans retour ce qu’ils ont créé.
II y a sept ou huit ans que la colonie américaine a fondé à Paris son culte par l’érection d’une chapelle, rue de Berri. Auparavant, on se réunissait rue de la Paix, dans l’ancien local des conférences. Les fonds nécessaires à la construction de cette chapelle ont été fournis par des dons et souscriptions, car les Américains, on le sait, sont assez fervents pour payer leur culte et ne demandent rien à l’État. On assure même, à ce propos, que les craintes des catholiques français relativement à une séparation de l’Église et de l’État les étonnent d’une manière pénible. — « Hé quoi ! disent-ils, ces gens-là, qui nous accusent volontiers de trop poursuivre les biens matériels, seraient capables de laisser jeûner leurs prêtres et périr leur foi, plutôt que de mettre la main à leur poche ! Et là-dessus ils secouent la tête, d’un air scandalisé, en émettant de grands doutes sur l’avenir de la catholicité, ce qui se conçoit de la part de protestants, et surtout de protestants assez convaincus pour porter à des milliers de francs leurs cotisations.
La chapelle américaine présente une nef assez large, soutenue par des colonnes de marbre rouge et au fond de laquelle est la chaire. Toute cette nef et les bas-côtés sont garnis de bancs, dont la location est la principale source du revenu qui solde le traitement du ministre et les frais du culte. On lit sur les bancs, en anglais, ce petit avis : Cette église est soutenue par la location des bancs, les quêtes, et les dons des résidents et des étrangers. Un orgue et les chants de voix jeunes et pures alternent avec les prières dites par le ministre.
Celui-ci, homme distingué d’esprit et de caractère, le doctor Eldridge, appartient à l’Église presbytérienne, et cependant la liturgie à laquelle il se soumet est celle du culte anglican. Voici la raison de ce fait singulier, si peu conforme aux mœurs théologiques généralement pratiqués :
II va sans dire que, citoyens d’un pays où les sectes florissent et se multiplient, drues comme les herbes des champs, les Américains résidant à Paris appartenaient à des communions différentes. On ne pouvait cependant songer à construire, dans la capitale française, les quelque mille églises ou chapelles de New-York.
Un seul moyen existait, s’unir. Mais l’union entre dissidents exige des concessions mutuelles. Or, devant cette entreprise de réunir dans une même chapelle des cultes divers et de soumettre à la nécessité le génie de la controverse, quel audacieux de notre ancien monde n’eût reculé ? Ces Américains ne doutent de rien. Ils essayèrent, et, de plus, ils réussirent.
Il est vrai qu’en Amérique les sectes, à force de se coudoyer, vivent en assez bonne harmonie. Elles se partagent les familles et se prêtent réciproquement leurs chaires. Les méthodistes varient ainsi l’ordinaire des presbytériens, les presbytériens celui des Baptistes, les Baptistes celui des Wesleyens et tutti quanti réciproquement. Deux sectes seulement vivent en dehors de cette fraternelle promiscuité, ce sont le chaînon du commencement et celui de la fin, les deux extrêmes : épiscopaux et unitariens ; c’est- à-dire le dogme absolu et le dogme indéfini ; l’un, bâti de ce granit dont on fait les tombes solides ; l’autre formé de ces vapeurs qui se dissipent au soleil. Les épiscopaux sont L’Église anglicane, autrefois établie d’autorité dans les colonies d’Amérique, l’ancien catholicisme romain, fait schisme par Henri VIII. L’unitarianisme est le frère jumeau du protestantisme libéral français.
Des unitariens il ne fut nullement question à propos de la chapelle américaine. Fortement soupçonnés de ne pas même croire à la divinité de Jésus, ces gens-là sont rejetés, par toutes les nuances- dé l’orthodoxie, en dehors de tout paradis. Mais on tenait à s’adjoindre les épiscopaux, riches, nombreux et influents. Par malheur, fidèles, en fait de concessions, à leur origine, les épiscopaux n’en font pas plus que l’Église romaine. Ce furent donc les presbytériens qui durent accepter le book-common-prayer (livre des prières communes), charte des non-libertés de l’Église anglicane, éditée avec soin par Jacques 1er, roi, comme on sait, très-capable de régler au plus juste les rapports de la terre avec le ciel. Ce livre contient, réunies aux psaumes, les principales prières catholiques, entre autres le Gloria in excelsis et le Credo, où se trouve retranché, après Église, le seul mot romaine. Enfin, le ministre presbytérien dut revêtir un costume assez semblable à celui des diacres, mais noir.
Il ne faudrait pas s’imaginer que toutes ces concessions ne fussent pas très-graves. De longues guerres ont eu lieu, et des nations se sont entre-dévorées à moins. C’était précisément par horreur pour ce costume et ce book-common-prayer que les fondateurs spirituels des États-Unis, les Pères Pèlerins, avaient abandonné leur patrie, souffert mille persécutions et mille traverses et s’étaient voués aux rigueurs de l’exil sur le sol aride et glacé du Massachusetts. Une telle défection de la part de leurs descendants peut donc nous faire, mesurer jusqu’à quel point l’esprit de tolérance a, de nos jours, envahi la foi, et cela nous paraît un des signes des temps les plus graves.
En revanche, les épiscopaux montrèrent combien ils étaient au-dessus de pareilles faiblesses. Chez eux, ni les flots de la Manche, ni ceux de l’Océan ne sont parvenus à effacer le baptême primitif des eaux du Tibre, et, seuls dans tout le protestantisme, ils refusent de prêter leurs chaires aux prêtres- des autres communions. On leur avait tout accordé ; mais, bientôt, ils rougirent de leur condescendance et s’indignèrent de partager le lieu de leur culte avec des sectaires égarés. Aussi viennent-ils de faire bâtir, dans la rue Bavard, sous le titre d’Église protestante épiscopale, une chapelle — non pas, ils rejettent le mot, — nous devons dire une église, bien qu’elle n’en soit pas plus grande pour cela. Malgré cette scission, le pacte conclu au sujet de la chapelle américaine continue d’y être observé. Nombre d’épiscopaux d’ailleurs y restent, par convenance de quartier. Les motifs d’ordre purement divin sont rares sur cette pauvre terre !
Nous aurons dit à peu près tout ce qui concerne les habitudes des Américains à Paris quand nous aurons parlé de leurs lectures. A cet égard, ils suivent naturellement, et sans choix approfondi, la mode littéraire, l’engouement du jour. Les hommes lisent, avant tout et surtout, les journaux, soit chez leurs banquiers, soit dans les salles de lecture du Grand-Hôtel, ou de l’hôtel du Louvre, qui offrent à tout venant, sans rétribution, la plupart des journaux anglais et américains, soit chez Galignani. Ils y joignent la lecture habituelle d’un journal français démocratique, et c’est l’Opinion nationale qui, généralement, a leurs préférences. Enfin il est fortement question, dans la colonie, de fonder à Paris un journal américain.
— Et maintenant, ô citoyens de l’Union, veuillez pardonner à un chroniqueur ami si, effleurant à peine, dans ces quelques pages, le vaste sujet de vos mœurs et de votre esprit national, il n’a pas appuyé uniquement sur l’éloge. Il n’ignore pas quelle sourde impatience vous causent de curieuses investigations et quelles épithètes vous décernez à d’impertinents voyageurs, coupables de n’avoir pas trouvé tout au mieux dans le meilleur des nouveaux mondes possible. Il sait avec quelle noble modestie vous acceptez les dithyrambes de vos enthousiasmes et avouez votre supériorité en tous genres sur cette pauvre Europe ; mais songez que, dans le cadre étroit qui lui était imposé ici, il ne lui était permis de vous peindre qu’en petit, et, par ce côté, où, trop humblement, vous vous "efforcez de ressembler à tout le monde.
Votre hospitalité, votre générosité, votre audace, vos créations, vos travaux immenses, vos institutions, votre liberté sont restés là-bas, dans votre patrie, et malheureusement il n’est pas en son pouvoir de leur faire franchir l’océan. Ce que vous apporter surtout à Paris, ce sont les prétentions de votre enfantine aristocratie, et bien qu’il ait rencontré parmi vous de ces cœurs chauds et de ces esprits élevés qui font estimer toutes les patries, il ne pouvait retrouver chez vos oisifs la sève puissante qui bout dans les veines de votre peuple. Il ne pouvait montrer les fruits admirables de cette liberté, ici paralysée par tant de défiances, qui là-bas, dans sa libre allure, sème tant de prospérités et de bienfaits.
L’occasion manquait à son désir de vous saluer comme les réalisateurs de nos dogmes, encore discutés parmi nous, et comme les hardis et sublimes inventeurs du Go a head (2).
(2) En avant !